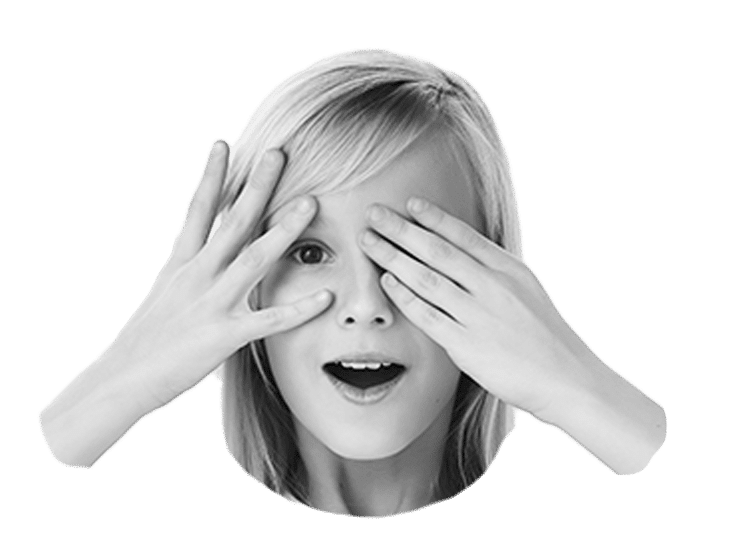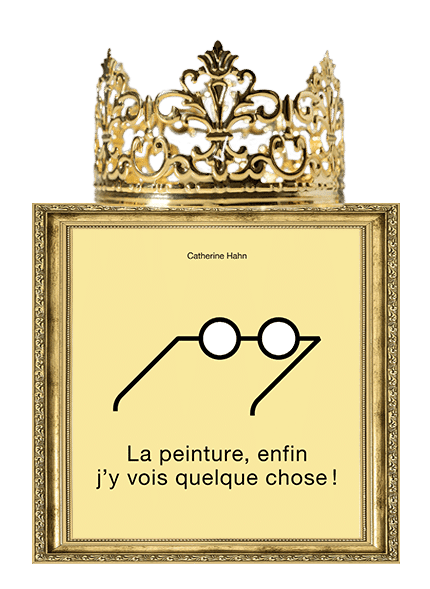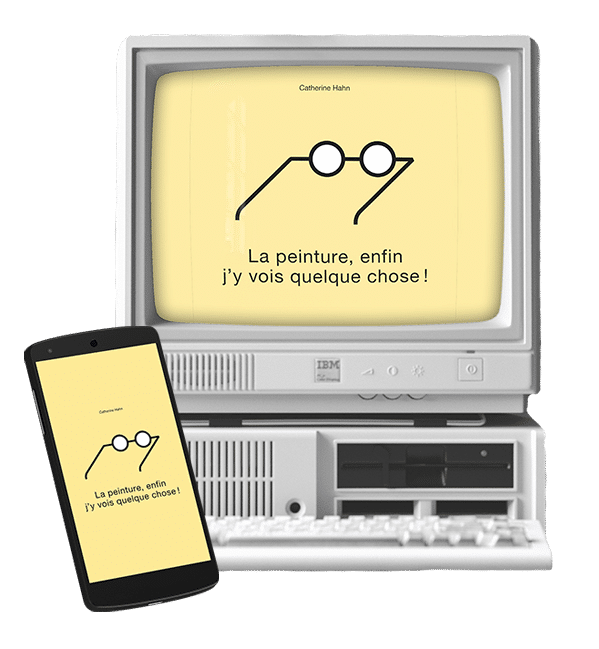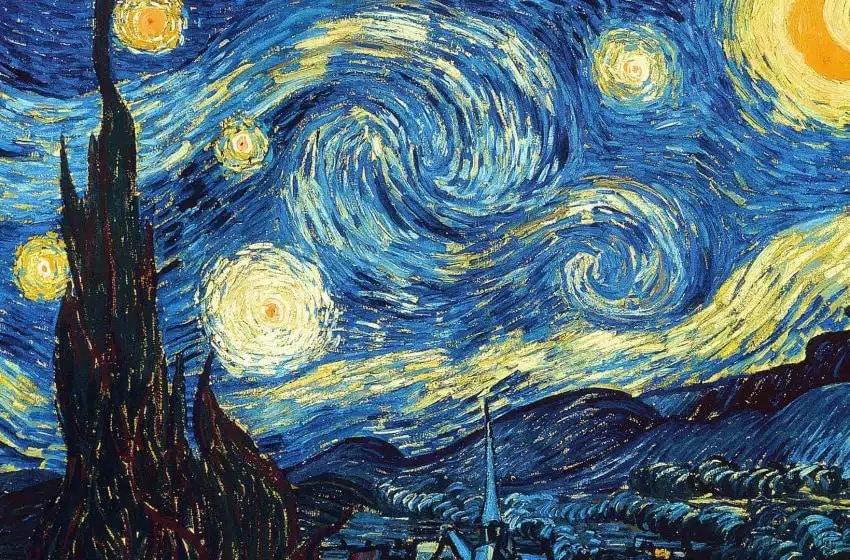Le jeu des 7 différences!
Le jeu des 7 différences, cela vous rappelle quelque chose ? Certainement, ce casse-tête qui consiste à trouver, malgré leur apparence identique, les différences sciemment introduites dans l’une des deux images. Eh bien, les conservateurs du Musée des Beaux-Arts de Lyon nous ont offert une opportunité d’y jouer dans l’exposition Zurbaràn Réinventer un chef-d’œuvre.

Comment les éléments picturaux changent tout?
Les trois tableaux représentant Saint François d’Assise de Francisco de Zurbarán, conservés à Lyon (Musée des Beaux-Arts), à Barcelone (Musée national d’Art de Catalogne, MNAC) et à Boston (Museum of Fine Arts), ont été réunis pour la première fois. Ainsi, dans une même salle, ces trois œuvres, qui partagent une esthétique commune mais présentent des variations subtiles, offrent un terrain de jeu extraordinaire.
Jouons ensemble au jeu des 7 différences avec Saint François !

Les trois tableaux représentant Saint François d’Assise de Francisco de Zurbarán, conservés à Lyon (Musée des Beaux-Arts), à Barcelone (Musée national d’Art de Catalogne, MNAC) et à Boston (Museum of Fine Arts), ont été réunis pour la première fois. Ainsi, dans une même salle, ces trois œuvres, qui partagent une esthétique commune mais présentent des variations subtiles, offrent un terrain de jeu extraordinaire.
Jouons ensemble au jeu des 7 différences avec Saint François !


Un thème, trois propos !
Zurbarán livre une représentation de Saint François d’Assise telle qu’il aurait été retrouvé par Nicolas V en 1449, dans la crypte de San Francesco d’Assise, où il était inhumé deux cents ans auparavant. Le saint lui serait alors apparu intact, debout, en extase. Selon un témoin présent, les faits auraient été les suivants :
Il était debout, droit, sans se tenir ni s’appuyer nulle part, ni sur le marbre, ni sur un mur, ni sur aucune autre chose. Il avait les yeux ouverts comme une personne vivante, et légèrement levés vers le ciel. Son corps n’avait subi aucune corruption. Il était de couleur blanche et rosée, comme s’il était vivant. Il avait les mains croisées sur la poitrine, comme les frères ont l’habitude de se tenir. Le pape souleva l’habit et vit les stigmates avec une plaie recouverte d’un sang aussi frais que récent.
Que voit-on ? Dans les trois versions, la vision du spectateur correspond à celle du pape. Saint François, habillé de sa robe de bure, est représenté en pied, les mains jointes, fixant un point indéterminé, devant une niche en cul-de-four sur laquelle son ombre est projetée.
Malgré de nombreuses similarités, notamment dans la composition, les trois versions du Saint François en extase de Francisco de Zurbarán (Lyon, Barcelone et Boston) présentent des différences notables que nous allons analyser ensemble à travers une grille de lecture des éléments picturaux.
Quand le cadre fait la différence !
L’effet produit est d’autant plus saisissant que les tableaux sont grandeur nature, mesurant plus de deux mètres de haut. Dans la version du musée de Boston, le cadre noir, décoré à la feuille d’or, est assez sobre et apporte un ornement discret au tableau sans attirer l’attention sur lui. Il met le sujet en valeur en y apportant un peu de lumière, faisant écho à celle de la représentation. Dans celle de Barcelone, le cadre noir, agrémenté d’une double baguette dorée, cerne et enferme la représentation, dont l’espace environnant est déjà réduit.
En troisième lieu, dans le tableau conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon, le cadre sculpté et doré est imposant, mettant le personnage en scène.
Quels sont les points d’accroche ? Le regard entre, dans les trois versions, par le visage du saint. Ensuite, il glisse, dans la version américaine, sur le vêtement en raison de la lumière diffuse, sur les mains jointes de celle de Barcelone en raison de leur matérialité et sur l’ensemble de la composition dans le tableau lyonnais grâce à l’agencement des éléments de la composition.
De l’air et l’atmosphère change !
Les trois tableaux ont probablement subi des réductions de format. L’analyse que nous allons tirer de ces compositions est basée sur ce que nous voyons aujourd’hui.
La composition de la version de Boston est la plus aérée, laissant passer un souffle derrière le personnage. Du fait de la portion d’espace, le sujet est intégré dans un environnement reconnaissable et qui prend une certaine importance. Une harmonie se dégage également en raison de cette zone vide entourant le personnage. En raison du socle, il semble aussi plus ancré que les deux autres. Dans le tableau catalan, il y a peu de vide autour du saint et très peu au-dessus de sa tête et sous ses pieds, ce qui a pour effet de tasser le sujet et d’attirer le regard presque exclusivement sur lui.
La composition du tableau conservé à Lyon est la plus harmonieuse, laissant un espace équilibré autour de Saint-François.
Une illusion différente !
Dans les trois versions, ce sont tant l’ombre portée du personnage, le dessin de la voûte que les jeux d’ombre et de lumière qui creusent la profondeur et rendent l’illusion de la perspective. Dans le tableau de Boston, la voûte est plus marquée et le socle visible offre un plus grand réalisme.
Et la lumière fit…l’impression !
On a l’impression d’une lumière artificielle dans le tableau de Boston et non d’une lumière du jour : le personnage semble rétroéclairé alors qu’il projette une ombre.
Dans la version de Barcelone, l’obscurité du fond est presque totale, donnant à la scène un aspect surnaturel. A l’inverse, la lumière dans des tons chauds semble provenir d’une bougie. Elle illumine la robe de bure et incarne le saint.
La lumière, bien que froide, du tableau conservé à Lyon, est très naturelle et semble provenir d’un soupirail.
On en voit de toutes les couleurs !
Le tableau de Boston montre une robe de bure faite d’un beige cireux, composé de bleu, qui apporte un aspect spectral au personnage, amplifié par son expression extatique et ses yeux révulsés. De plus, l’ensemble des couleurs semble anecdotique ; je ne serais pas étonnée d’apprendre que cette version a été réalisée par l’atelier de Zurbarán plutôt que par le maître lui-même.
La version de Barcelone offre les couleurs les plus chaudes, le beige de la robe de bure contenant du rouge matérialise le personnage, lui donnant une présence, voire une humanité. Le visage, grâce au rosé des joues, semble presque débonnaire.
Quant à la version lyonnaise, le beige terreux de la robe de bure est ici assez « réaliste » ; un ton composé de vert et d’un soupçon de rouge forme une couleur neutre, terne. Les couleurs sont assez naturelles, locales.
Une question de posture !
Dans toutes les versions, Saint François d’Assise est représenté en habit franciscain, absorbé dans une contemplation mystique, le regard tourné vers une lumière divine invisible. L’approche de Zurbarán, inspirée du ténébrisme caravagesque, met en scène le saint dans un environnement dépouillé, baigné de contrastes lumineux dramatiques.
La version du MBA de Lyon se distingue par une posture plus rigide du saint, avec un visage presque figé dans l’extase. Les ombres sont plus marquées, accentuant l’effet sculptural du personnage et une théâtralité. La lumière vient d’en haut à gauche, creusant profondément les traits et donnant une présence austère au saint.
L’attitude du saint du Museu Nacional d’Art de Catalonya, le MNAC, est légèrement plus souple, et le clair-obscur moins violent. L’éclairage est plus diffus, donnant une douceur plus prononcée à la scène. On perçoit un modelé plus délicat du visage, qui le rapproche davantage d’une expression de recueillement que d’une vision saisissante. Et pour terminer, dans la version du Museum of Fine Arts de Boston, le traitement des tissus et les jeux de lumière sont considérés comme les plus raffinés. Le visage est traité avec une touche plus subtile et poétique, avec une expression plus paisible que transcendante. L’arrière-plan est plus lisible que dans la version lyonnaise.
L’habit ne fait pas le moine !
Zurbarán, maître du rendu des étoffes, joue dans les trois tableaux avec la matérialité de l’habit franciscain. Celui de Boston donne l’impression qu’il sort du teinturier ! Le tissu est représenté sans aspérité, sans matière, presque lisse. Cette rigidité accentue l’idée d’une personne détachée du monde matériel. Dans la version de Barcelone, un modelé plus fondu, avec des plis plus souples et une lumière plus diffuse, apporte une matérialité, presque une sensualité à l’ensemble. Tandis que le fort contraste entre lumière et ombre du tableau de Lyon met en valeur les plis rigides du vêtement, créant un effet presque sculptural tout en rendant une certaine matérialité.
Les visages de l’extase : de la sérénité au vertige mystique
Notre Saint-François de Boston offre une attitude plus sereine, moins dramatique mais aussi plus artificielle que les deux autres. Je lui trouve un air presque dubitatif.
Celui de Barcelone est plus méditatif, présentant une extase intérieure plus douce. Son habit est traité avec une minutie saisissante, chaque pli étant ciselé par une lumière chaude et humaine. L’expression pourrait dénoter une attente, la grâce divine ne semble pas encore lui avoir été accordée. Et finalement, le Saint-François de Lyon nous offre une extase austère, presque hiératique : il est comme possédé, ou pour le moins transcendé par ce qu’il reçoit à ce moment-là.
Un seul saint, trois versions et des wagons de différentes…interprétations !
À l’issue de cette enquête picturale minutieuse, une évidence s’impose : si Saint François d’Assise est toujours debout, imperturbable dans sa contemplation mystique, nous, en revanche, avons bien dû nous pencher sur lui sous toutes les coutures !
Trois tableaux, trois ambiances :
- À Boston, un saint presque spectrale, qui aurait pu inspirer un film d’auteur un brin ésotérique.
- À Barcelone, une extase feutrée, à la lumière d’une bougie, qui nous rapproche d’une vision plus intime et méditative.
- À Lyon, une théâtralité dramatique, où chaque ombre et chaque pli du vêtement semblent sculpter la ferveur mystique du personnage.
Alors, au terme de cette chasse aux différences, faut-il désigner un vainqueur ? Que nenni ! Chacune des versions éclaire un aspect de la spiritualité et de l’art de Zurbarán. À nous de choisir si l’on préfère un saint extatique, méditatif ou possédé… ou de s’en remettre, pourquoi pas, au hasard des apparitions muséales.
En attendant, une chose est sûre : dans ce jeu des 7 différences, personne n’a triché. Sauf peut-être Zurbarán lui-même, qui nous laisse encore douter de sa propre main dans certaines versions. Mais après tout, n’est-ce pas là le propre des chefs-d’œuvre que de toujours nous surprendre ?
Et pour compléter votre compréhension des codes d’un tableau, procurez-vous la méthode complète ou téléchargez gratuitement le pense-bête Art-toi.
ART-TOI et vois plus et mieux !